« Laisse le travail des vautours aux vautours », martèle Ossiri à son copain Kassoum, un peu tenté par le vol. C’est le comble pour un vigile, et c’est aussi une sublime ironie, car si le voleur est vautour, qu’est-ce que l’homme qui voit sans être vu, avant de fondre sur sa proie ? Dans ce premier roman, Gauz écrit le quotidien d’immigrés africains, devenus vigiles dans les grands magasins. Il a bien conscience que ses personnages de vigiles noirs et impassibles à Sephora font cliché, mais ce n’est que le reflet fidèle des raccourcis de pensée de notre époque, et il en prend bonne note en écrivant qu’il est « Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeillent de façon atavique à la fois dans chacun des blancs chargés du recrutement, et dans chacun des noirs venus exploiter ces clichés en sa faveur. ». A travers le pretexte de la vigilance de ses personnages, Gauz porte un regard à 360° sur la société contemporraine, frappée par une double crise sociale (c’est l’histoire de l’immigration par ceux qui la vivent) et économique (c’est l’histoire de la société de consommation). Les cris de la ville et la rumeur du monde sont à merveille consignés dans des fragments tantôt philosophiques, tantôt historiques, parfois scientifiques. Ces fragments, venant de quelque part entre les Pensées de Pascal et les Maximes de La Rochefoucauld, proposent sous forme d’aphorisme un manuel d’appréhension du quotidien dérisoire. Loin de tenir un registre sur quelques cas architypiques de la misère sociale, Gauz propose au regard de son lecteur une autre forme de cliché, des instantanés de la vie quotidienne et pourtant tue de Paris. Cette écriture par listes, c’est l’écriture de nos temps modernes dans leur cacophonie. Pas « ramassis de clichés », non, roman photographique, et quelle prouesse d’inventivité narrative que de réussir aussi magistralement à féderer ces lambeaux triviaux de quotidien !
cliché, mais ce n’est que le reflet fidèle des raccourcis de pensée de notre époque, et il en prend bonne note en écrivant qu’il est « Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeillent de façon atavique à la fois dans chacun des blancs chargés du recrutement, et dans chacun des noirs venus exploiter ces clichés en sa faveur. ». A travers le pretexte de la vigilance de ses personnages, Gauz porte un regard à 360° sur la société contemporraine, frappée par une double crise sociale (c’est l’histoire de l’immigration par ceux qui la vivent) et économique (c’est l’histoire de la société de consommation). Les cris de la ville et la rumeur du monde sont à merveille consignés dans des fragments tantôt philosophiques, tantôt historiques, parfois scientifiques. Ces fragments, venant de quelque part entre les Pensées de Pascal et les Maximes de La Rochefoucauld, proposent sous forme d’aphorisme un manuel d’appréhension du quotidien dérisoire. Loin de tenir un registre sur quelques cas architypiques de la misère sociale, Gauz propose au regard de son lecteur une autre forme de cliché, des instantanés de la vie quotidienne et pourtant tue de Paris. Cette écriture par listes, c’est l’écriture de nos temps modernes dans leur cacophonie. Pas « ramassis de clichés », non, roman photographique, et quelle prouesse d’inventivité narrative que de réussir aussi magistralement à féderer ces lambeaux triviaux de quotidien !
Gauz, écrivain scientifique, tente de systématiser, de légiférer et de soigner et résoudre le chaos du monde – belle et louable entreprise de la part de quelqu’un qui aurait pu être vétérinaire. Son regard cru et sans fard embrasse tous les espaces, interroge le paysage urbain rendu invisible par l’habitude (« L’ANGE. Place de la Bastille, l’Ange doré est toujours nu au-dessus de son obélisque. Les anges étant assexués, il pourrait s’habiller indifféremment chez Camaïeu ou chez Celio. Comment lui dire que ce sont les soldes ? »), et prend à bras le corps le quotidien, comme un objet de pensée totalement neuf, avec une ironie ravageuse. Il cherche à faire rentrer les évenements dans des lois scientifiques, et en meme temps montre leur débordement, toujours avec humour, comme cette « THEORIE DU DESIR CAPILLAIRE ». Les désirs capillaires contaminent de proche en proche en direction du nord : la Beurette, au sud de la Viking, désire les cheveux raides et blonds de la Viking ; la Tropiquette, au sud de la Beurette, veut les cheveux bouclés de la Beurette. » Mais cette écriture géniale qui universalise le quotidien grâce aux lois mathématiques menace parfois de nous faire oublier que rien n’est prononcé, que tout n’est que parole silencieuse déployée depuis un espace intime, et que ces êtres vigilants sont vertigineusement seuls. Et en ce sens, Gauz nous rappelle que mathématiques et poésie tentent toutes deux de mesurer et définir le monde, et que la loi et le vers sont cousins – lui flirte de l’une à l’autre, sans complexe :
« L’ATTRIBUT. Vigie, l’attribut de ceux qui restent debout.
LA TRIBU. Vigiles, la tribu de ceux qui restent debout. »
Une telle volonté anthologique prend trop souvent le pas sur l’ontologie du roman : à prétendre tout décrire de ce qui passe dans un certain point de vue, qu’est-ce qui fait l’unité du roman ? N’a-t’on pas affaire à un récit fait de bric et de broc ? En réalité, c’est l’histoire du lieu qui rassemble tout ces éclats : la MECI (Maison des Etudiants de la Côte d’Ivoire), de son âge d’or à sa dissolution, sur deux générations. Mais c’est également l’histoire d’une vision : loin de simples pensées agrégées sans but, les fragments sont autant d’instantanés pris avec le même appareil photographique, à savoir les yeux d’un vigile, fictif comme mémoriel, car l’on apprend dans le dernier chapitre que Gauz a exercé ce métier. D’ailleurs, ce n’est pas le seul lien qui relie l’auteur à ses personnages : Kassoum, en particulier, connaît le même destin amoureux que son créateur. Plus qu’un quotidien partagé, c’est donc la vie réelle et vécue de Gauz qui perfore la fiction : le dernier chapitre n’est autre que son autobiographie, certes rapide, mais écrite comme le reste du roman, avec humour, par listes, en tentant de faire scrupuleusement le tour des choses. Gauz bouscule notre sens de lecture en faisant le geste très fort d’incorporer la biographie dans la fiction. Debout-Payé est également un roman qui donne ses mots pour le lire, en proposant un lexique très drôle, parce que tout bon mot est un jeu de mot – comme ces « réunnionnais », qui loin d’être tous Antillais, sont en fait ceux qui convoquent des réunions à tout bout de champ. Et c’est cela aussi l’extrême générosité de Debout-Payé : mettre en mots la richesse intérieure des muets, montrer comment ceux qui paraissent aimables comme des portes de prison s’emparent de la langue avec une liberté délirante.
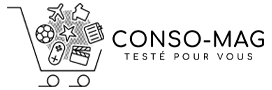
![[LIVRE] Twisted Games de Ana Huang](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/twistes-games.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)


![[LIVRE] Étoiles du Nord, de Brittainy C. Cherry](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/etoiles-du-nord.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)
![[Test PS4] The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/07/The-Legend-of-Heroes_-Trails-through-Daybreak_20240707083833.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)
![[LIVRE] À l’Ouest, Les Vagues de Brittainy C. Cherry](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/a-louest-les-vagues.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)

![[LIVRE] Lueurs de l’Est, de Brittainy C. Cherry](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/lueurs-de-lest.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)





![[LIVRE] De quoi as-tu besoin ?! chez F1rst Editions](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/dequoiastubesoin.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)



![[Test Hardware] Ecouteurs Skullcandy ECOBUDS](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/04/SKULLCANDY_ECOBUDS_3499E-6-scaled.jpg?resize=360%2C180&ssl=1)














![[Test PS4] The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/07/The-Legend-of-Heroes_-Trails-through-Daybreak_20240707083833.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)


![[LIVRE] Étoiles du Nord, de Brittainy C. Cherry](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/etoiles-du-nord.jpg?resize=120%2C86&ssl=1)
![[Test PS4] The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/07/The-Legend-of-Heroes_-Trails-through-Daybreak_20240707083833.jpg?resize=120%2C86&ssl=1)








![[LIVRE] Twisted Games de Ana Huang](https://i0.wp.com/www.conso-mag.com/wp-content/uploads/2024/06/twistes-games.jpg?resize=120%2C86&ssl=1)
